Richenda Grazette est la Coordonnatrice, Leadership et capacités communautaires au centre de la transformation sociale SHIFT. Richenda travaille à la création de possibilités de subventions novatrices et accessibles pour des projets de transformation sociale à Concordia et à Montréal. Elle dirige également les processus de sélection participatifs qui sont essentiels à la création d'un pouvoir partagé, en donnant aux membres de la communauté le leadership dans les décisions de financement. Avant SHIFT, elle a passé une dizaine d'années dans les secteurs à but non lucratif et philanthropique de Montréal.
Au revoir, DEI: Moins de travail, plus de jeu
par Richenda Grazette
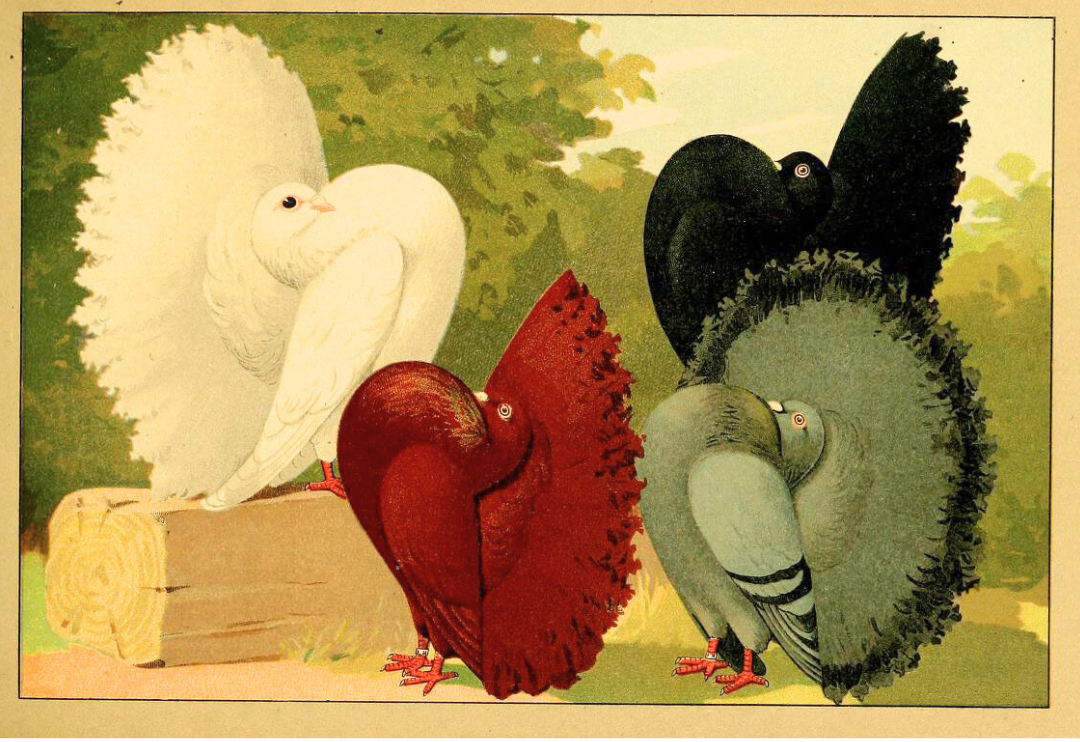 Image from the Biodiversity Heritage Library, via Flickr
Image from the Biodiversity Heritage Library, via Flickr
Voici le deuxième article de notre série en trois parties intitulée Au revoir, DEI, le premier à être rédigé conjointement par Richenda Grazette et Maureen Adegbidi. Nous vous invitons à lire tout d’abord l’article précédent afin de mieux comprendre le contexte et l’approche du présent texte.
Les enfants découvrent le monde qui les entoure, leurs centres d’intérêt et leurs talents par l’exploration et le jeu; pourquoi les adultes ne pourraient-ils pas faire de même?
Le secteur à but non lucratif – en particulier les groupes communautaires – a joué un rôle de premier plan dans la définition et l’instauration de cultures d’entreprise progressistes : il a été le fer de lance de l’intégration d’un principe que nous appelons aujourd’hui « diversité, l’équité et l’inclusion », a institué la semaine de travail réduite et les horaires flexibles, et établi des structures de gouvernance alternatives ou non hiérarchiques. Cependant, le secteur communautaire et philanthropique, en général, est en retard sur les entreprises et le domaine de la technologie sur un aspect essentiel : le jeu. Nous ne parlons pas ici de l’installation de tables de ping-pong au bureau (bien que ce ne soit pas une mauvaise idée pour certains d’entre nous), mais plutôt du jeu intégré à l’exécution de nos fonctions : expérimentation de façons différentes d’exécuter nos tâches, mise à l’essai de nouvelles idées et exploration de projets qui nous passionnent.
Qu’en serait-il si nous ne nous contentions pas d’autoriser, mais choisissions d’encourager les membres de notre personnel à s’écarter des limites de leur description de tâches
Les notions de « jeu » et de « lieu de travail » peuvent sembler mutuellement exclusives, en particulier dans les secteurs à but non lucratif et philanthropique, où le non-respect d’une échéance peut avoir des conséquences dramatiques sur la vie ou les moyens de subsistance des personnes qui dépendent de nous. Mais dans un secteur où l’on privilégie le recrutement d’un personnel « représentatif des communautés que l’on veut servir » (du moins d’après ce qu’on nous dit), notamment dans les milieux communautaire et philanthropique, nous ne parvenons pas à créer un espace permettant aux diverses perspectives de se faire valoir, pas plus que nous n’arrivons à utiliser le jeu comme tactique de lutte contre l’oppression ou à apporter des changements transformateurs à la fois à la culture du travail elle-même et à la manière dont nous soutenons notre clientèle, nos bénéficiaires de subventions et nos communautés. Les organismes qui cherchent à recruter sur la base de compétences transférables et d’expériences vécues n’offrent souvent pas aux membres du personnel nouvellement embauchés une formation adéquate ou suffisamment d’espace pour favoriser leur croissance, ni assez d’autonomie pour encourager l’expérimentation, ce qui peut nuire à la satisfaction de leurs besoins intrinsèques en matière de travail ainsi qu’à leur motivation. Plus généralement, le fait de ne pas accorder suffisamment de place au jeu et à la joie dans le cadre du travail accélère les cycles d’épuisement professionnel, constitue un obstacle à l’innovation et renforce la résistance au changement : lorsque nous concentrons toute notre énergie sur les tâches urgentes ou immédiates, nous ne disposons pas de l’espace nécessaire pour repenser le « comment » de notre travail ou pour améliorer la culture organisationnelle.
Qu’en serait-il si nous ne nous contentions pas d’autoriser, mais choisissions d’encourager les membres de notre personnel à s’écarter des limites de leur description de tâches, à entreprendre de nouveaux projets ou à essayer de nouvelles approches, et à acquérir de nouvelles compétences? En utilisant des mots tels que « jeu » ainsi que « expérimentation », nous tentons de recadrer l’objectif de ce changement dans le milieu de travail en vue d’arriver à quelque chose de plus léger, de moins axé sur les résultats et de moins scientifique. En d’autres mots, pouvons-nous essayer de nouvelles choses sur nos lieux de travail, juste pour le plaisir?

Théorie du jeu
Refus d’une approche selon laquelle l’expérimentation doit absolument produire des résultats.
Les organismes communautaires et philanthropiques devraient considérer le jeu et le plaisir dans le cadre de la pratique militante comme des bases théoriques et des modèles à adopter. Prenons l’exemple de cette conversation entre deux personnes œuvrant en organisation communautaire, Kai Tzeng et KJ Kearny, qui expliquent comment elles intègrent le jeu au sens littéral (jeux et improvisation) dans leur travail culturel. Pour ces personnes, le jeu « est plus qu’une simple activité, c’est un état d’esprit. Il stimule la créativité, apporte du plaisir et favorise l’innovation; c’est un choix de faire quelque chose qui représente un défi à relever dans un espace sûr ». Kai Tzeng et KJ Kearny soulignent qu’en se prêtant à des jeux, à des « exercices d’imagination » et à de la création artistique, les gens deviennent mieux à même d’« élargir leurs horizons et de rêver à de nouvelles possibilités et façons d’être ou d’interagir ».
Le jeu et l’expérimentation répondent à des besoins intrinsèques en milieu de travail tels que la réussite, l’avancement, la concordance avec ses propres valeurs et la croissance. Lorsque nous envisageons d’ajouter plus de jeux expérimentaux dans le lieu de travail, nous devons garder à l’esprit que le but n’est pas d’accroître la productivité de notre organisme, mais qu’il s’agit plutôt d’améliorer l’expérience des membres du personnel et la culture de travail. La priorité est l’apprentissage, le développement et le plaisir de ces personnes, et non les avantages que ces changements apporteront aux parties prenantes.
L’expérience d’apprentissage des membres du personnel revêt une importance capitale. Qu’ils aient accès à des programmes de formation structurés ou qu’ils apprennent sur le tas, les employé·e·s se voient accorder du temps et de l’espace supplémentaires pour s’adonner à des passions qui les aideront à progresser dans leur carrière future ou qui renforceront leur motivation dans leurs fonctions actuelles; on place la joie au cœur du processus plutôt que d’assujettir le personnel à une description de poste. Comme le dit Cyndi Suarez, le jeu « permet de vivre de nouvelles situations », d’expérimenter d’autres façons d’être et d’imaginer l’avenir. Lorsque nous investissons dans la croissance des personnes, en particulier les membres de groupes traditionnellement marginalisés, nous renforçons leurs compétences individuelles, ce qui constitue un atout pour le secteur dans son ensemble : les membres du personnel acquièrent une meilleure capacité à collaborer; ils sont plus susceptibles d’envisager de rester dans un emploi ayant un impact social et d’aimer davantage ce qu’ils font.
Le jeu et l’expérimentation vont directement à l’encontre de la conception capitaliste du travail. La raison d’être de votre organisme est-elle d’œuvrer à un changement systémique? Si c’est le cas, pourquoi votre culture interne est-elle si différente du monde que vous essayez de bâtir?
Le jeu, une libération
Le jeu et l’expérimentation vont directement à l’encontre de la conception capitaliste du travail. La raison d’être de votre organisme est-elle d’œuvrer à un changement systémique? Si c’est le cas, pourquoi votre culture interne est-elle si différente du monde que vous essayez de bâtir?
Comme Maureen et moi-même en discutions dans notre article du mois dernier, la culture de la suprématie blanche et la culture capitaliste dans les milieux de travail s’appuient sur le sentiment d’urgence, le perfectionnisme et la concentration du pouvoir (entre autres facteurs) pour maintenir des espaces où l’oppression demeure solidement ancrée. Ces facteurs réduisent les possibilités d’expression réelle de la diversité des opinions et des expériences et de partage du pouvoir, et compromettent l’accès des groupes marginalisés ou des jeunes employé·e·s au développement professionnel et personnel dont ils ont besoin. Depuis des décennies, des théoricien·ne·s féministes et queer – en particulier les intellectuelles féministes Patricia Hill Collins et Audre Lorde – mettent de l’avant le concept selon lequel le soin de soi constitue un acte radical. Bien qu’il s’agisse d’une interprétation très libre de leurs œuvres originales, nous pouvons considérer le jeu comme une tactique permettant de briser avec la culture de la suprématie blanche dans les lieux de travail et de nous en libérer.
C’est ici que le jeu entre en scène. Un véritable parti pris pour une culture axée sur l’expérimentation peut entraîner un changement radical dans la façon dont les employé·e·s s’investissent dans leur milieu de travail. Au lieu de s’inspirer des modèles d’entreprise, les organismes communautaires et philanthropiques devraient adopter les pratiques de jeu et de plaisir des milieux militants comme bases théoriques et modèles à adopter. Cyndi Suarez dit (dans l’extrait The Purpose of Play), selon qui le jeu « procure un espace exempt de pénalité où l’on peut s’exercer aux divers compromis et concessions sociales inhérents à la vie en communauté » : il fonctionne de manière fractale et permet de pratiquer à une échelle plus modeste ce que nous voudrions voir dans l’ensemble de la société. Ou, comme le dit Adrienne Marie Brown, il permet de « considérer notre propre vie et notre travail comme une ligne de front, un lieu premier où nous pouvons nous initier à la justice et à la libération et apprendre comment exister en harmonie les uns avec les autres et avec a planète ». N’envisageons-nous pas une société où régnerait plus de fluidité et une plus grande possibilité de mouvement pour tous, où nous pourrions suivre nos champs d’intérêt pour enrichir nos connaissances et nos compétences?
Au Centre SHIFT, nous avons institué une culture de travail hautement expérimentale, fluide et itérative. Nous disposons d’une grande latitude dans la conception de nos postes et de nos programmes de même que dans le choix des intervenant·e·s que nous consultons. De plus, nous pouvons faire des erreurs dans le processus d’apprentissage. Prenons par exemple nos programmes de financement. Nous les reformulons à chaque cycle de subventions; chaque fois que nous constatons que tel ou tel critère « ne s’avère plus pertinent », nous faisons un pas de plus vers une compréhension plus approfondie de la façon de procéder pour établir des systèmes de financement plus accessibles, et pour faire en sorte que le Centre SHIFT arrive à mieux répondre aux besoins du secteur. Nous saisissons également mieux comment différentes identités, habiletés et capacités influent sur la façon dont les comités de sélection évaluent les demandes et prenons conscience du potentiel que nous n’avons pas encore mis à contribution dans les programmes. Tout cela est possible, car nous avons l’assurance de pouvoir faire des erreurs en toute sécurité – nous refusons le perfectionnisme, et notre style de travail consiste à apprendre tout en offrant nos services. Grâce à ces échecs, j’apprends comment mieux appliquer ce qu’on appelle la DEI dans mon travail, tout en faisant savoir aux intervenant·e·s que j’apprends avec eux et grâce à eux.
Le jeu et l’expérimentation rendent également les lieux de travail beaucoup plus accessibles. Culturellement, le jeu et l’expérimentation requièrent un ralentissement du rythme de travail ainsi que des descriptions de poste moins structurées. L’aménagement d’horaires flexibles rend non seulement les employé·e·s mieux en mesure de réagir aux nombreux imprévus de la vie, mais leur permet de mieux comprendre leur type de cerveau et leurs besoins particuliers en matière d’accessibilité, et d’adapter leur travail en conséquence. Cela s’applique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leurs domaines spécifiques; ils peuvent ainsi modifier leurs flux de travail en fonction de leur façon de travailler et découvrir de nouveaux domaines dans lesquels ils peuvent s’illustrer.
L’investissement dans le jeu et l’expérimentation se nourrit d’une culture fondée sur la confiance et la sécurité des employé·e·s, et alimente cette culture en retour. Rien n’illustre mieux cette confiance que l’allocation de temps libre au cours de la semaine de travail, que les employé·e·s peuvent utiliser pour approfondir l’expertise acquise dans le cadre de leurs expériences vécues et professionnelles. Lorsque les membres du personnel sentent que leurs idées sont appréciées, respectées et mises en valeur, et qu’ils disposent d’une latitude suffisante pour les concrétiser, leur sentiment d’appartenance et de confiance s’accroît, ce qui – rappelons-le – brise les hiérarchies oppressives et professionnelles au profit d’un lieu de travail plus inclusif, démocratique et axé sur les valeurs.
Pour commencer
L’essai de Jo Freeman intitulé The Tyranny of Structurelessness (« la tyrannie de l’absence de structure ») aborde les risques que courent les organismes et les mouvements qui n’ont « pas de structure », cette situation étant susceptible de favoriser la reproduction inconsciente des dynamiques de pouvoir dominantes et sociétales. Cette idée semble particulièrement pertinente au regard du jeu et de l’expérimentation : tant les membres de la direction que les membres du personnel devraient réfléchir à ce que signifierait la création d’une infrastructure de jeu intentionnelle (un terrain de jeu, en quelque sorte) qui soutienne l’investissement des employés dans leur propre apprentissage, tout en clarifiant pour tous ce que signifie l’expérimentation et quelles formes elle peut prendre.
La pleine intégration du jeu en milieu de travail est un processus long et réfléchi menant à un changement de culture. Mais il existe des changements ou des processus que vous pouvez explorer immédiatement au travail pour commencer à faire connaître cette intention et engager des conversations au sein de votre équipe sur la création d’un lieu de travail différent, un lieu ouvert aux échecs féconds, à la croissance, à une culture plus saine, à des services améliorés et, en fin de compte, à l’innovation.
1. Revoir les descriptions de poste
Essayez de prévoir un certain nombre d’heures (par semaine, par mois ou autre, selon votre structure actuelle) pour intégrer des « projets d’intérêt » dans les contrats et les descriptions de poste. Cette mesure devrait s’ajouter au perfectionnement professionnel et être présentée comme un « espace libre » voué à l’exploration. Aucun livrable ne doit être attendu au terme de cette ce temps libre, et les employé·e·s qui s’y prêtent doivent comprendre qu’il s’agit de temps voué au rêve et à l’apprentissage, sur des aspects s’inscrivant ou non dans leur description de poste.
Si, dans votre milieu de travail, le personnel est « trop occupé pour qu’il soit possible de consacrer du temps à l’exploration », il vaudrait la peine de réfléchir aux moyens de réduire les résultats attendus. Là encore, le fait d’exempter les employés des orientations à court terme, du sentiment d’urgence et de la contrainte au perfectionnisme les aidera à se sentir mieux et à être plus performants à long terme.
2. Investir dans l’apprentissage
De toute évidence, il est essentiel d’investir des ressources dans la formation, mais pas uniquement pour les activités qui font explicitement partie des responsabilités de l’employé·e. Si vous pouvez vous le permettre, créez un budget de perfectionnement professionnel et personnel que les employés peuvent utiliser à leur discrétion. De plus, veillez à ce que vos employé·e·s se prévalent de ces budgets plus libres en les encourageant à réfléchir à ce qu’ils souhaiteraient apprendre et en les aidant à trouver l’endroit où le faire. Rappel : les expériences ou le matériel (comme les livres) sont tout aussi valables que les conférences et les ateliers ; faites donc preuve d’ouverture à l’égard de tout ce que l’employé·e juge important.
3. Assurer un suivi
Lors de vos rencontres de suivi régulières avec votre personnel ou vos collègues, faites preuve d’une écoute attentive et engagez un dialogue sur leurs centres d’intérêt. Cela est important pour les supérieurs hiérarchiques : en discutant ouvertement de la manière dont vous utilisez le temps consacré à vos champs d’intérêt dans le contexte du travail et en donnant l’exemple en cette matière, vous validez la pertinence du jeu (et l’importance d’y consacrer du temps) auprès des personnes que vous supervisez. Voici quelques questions que vous pourriez poser lors de ces entretiens réguliers :
- Y a-t-il un domaine au sujet duquel vous souhaiteriez en savoir plus ou que vous aimeriez explorer, lié ou non à votre domaine de travail?
- Je remarque que vous n’avez pas encore utilisé votre budget de perfectionnement professionnel ou personnel cette année. Pouvons-nous établir un plan sur la manière dont vous pourriez l’utiliser, et établir un calendrier?
- Y a-t-il un projet dont vous rêvez et que vous n’avez pas encore trouvé le temps de réaliser? Dites-nous-en davantage sur ce rêve et sur ce qui le rend emballant à vos yeux.
- Aimeriez-vous que nous prenions le temps d’examiner les possibilités au cours des prochains mois et comment vous pourriez trouver du temps pour ce projet?
- Comment se déroule votre projet ou votre apprentissage? Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez changer en ce qui a trait au déroulement du projet? Aimeriez-vous ajouter des éléments ou en enlever, et pourquoi?
4. Curiosité et volonté d’apprendre
Lorsqu’une expérience échoue ou n’est pas pertinente pour l’organisme, engagez une conversation visant à déterminer les raisons de cet état de fait et les changements qui pourraient être apportés dans les itérations suivantes. L’échec d’un aspect du projet ou de la totalité de celui-ci ne doit pas entraîner l’annulation dudit projet, mais plutôt sa réorientation. Voici quelques questions auxquelles vous pouvez réfléchir ou dont vous pouvez discuter avec vos collègues à la suite d’un « échec » :
- Quels sont les principaux points à retenir de cette expérimentation ou de ce projet?
- Quels aspects de cette expérimentation ou de ce projet voudriez-vous conserver? Il peut s’agir d’idées, d’approches ou d’objectifs, ou de certaines des activités.
- Quels aspects de cette expérimentation ou de ce projet aimeriez-vous améliorer, modifier ou abandonner? Précisez de quoi il s’agit.
- Avez-vous besoin d’aide pour réorienter le projet ou corriger votre stratégie? Avez-vous besoin d’acquérir d’autres connaissances avant de réessayer, et pouvons-nous vous aider à obtenir ces connaissances?
Le fait d’encourager le jeu et l’expérimentation en milieu de travail peut s’apparenter à une tâche irréalisable, en particulier dans les organismes à but non lucratif de petite taille ou axés sur les services, dont le budget et le temps sont limités et qui doivent faire face à des exigences déjà pratiquement impossibles à remplir de la part de la clientèle. Mais les avantages et le potentiel que ce défi recèle ne peuvent être sous-estimés : en accédant à d’autres parties de notre cerveau et en puisant dans notre créativité, nous contribuons à instaurer un lieu de travail plus inclusif qui attire un personnel talentueux et passionné pour qui ce type de contexte est essentiel. La liberté d’explorer et d’avoir du plaisir au travail, tout en bénéficiant d’un espace d’atterrissage sûr lorsque (inévitablement) les expériences ne donnent pas les résultats escomptés, est un exemple éloquent de changement culturel que tout organisme peut effectuer afin de rendre le lieu de travail véritablement plus diversifié et plus équitable, au-delà des simples intentions; on met ainsi en place de nouvelles infrastructures qui sont avantageuses pour tous.




