Comme l’illustre son financement provenant de sources externes de 1,6 million de dollars en 1975-1976, les premiers efforts de recherche de Concordia étaient limités. « Au début, nous étions plus ou moins un établissement de premier cycle », rappelle Heather Adams-Robinette, directrice principale du Vice-rectorat à la recherche, à l’innovation et au rayonnement de Concordia. Mais après ces débuts modestes, l’Université a commencé à élargir progressivement ses sujets de recherche.
Au début des années 1980, le Département de psychologie a accueilli le Centre de recherche en développement humain et le Groupe de recherche en neurologie comportementale (GRNC).
« À l’époque, le GRNC était le seul centre financé par le Fonds de recherche du Québec – Santé qui ne faisait pas partie d’une faculté de médecine, et il était donc considéré comme un exemple remarquable de réussite en matière de recherche », raconte Mme Adams-Robinette.
Au cours des années qui ont suivi, et plus particulièrement à partir des années 2000, Concordia a élargi son empreinte de recherche en créant un certain nombre de centres et d’instituts. Ces espaces rassemblent des spécialistes exceptionnels de l’Université et d’ailleurs afin de favoriser la collaboration et de faire progresser les connaissances.
Mme Adams-Robinette souligne qu’une autre étape cruciale a été franchie en 2006, lorsque la personne responsable de la recherche est passée du rang de vice-recteur exécutif adjoint à celui de vice-recteur. « Il s’agissait de reconnaître que, si nous voulions progresser en tant qu’établissement de recherche, nous avions besoin d’un vice-recteur ou d’une vice-rectrice à la recherche », précise-t-elle. Cette année-là, Louise Dandurand a été la première à prendre la tête du Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures de l’Université – devenu ensuite le Vice-rectorat à la recherche, à l’innovation et au rayonnement.
Faire avancer les choses
En janvier, Concordia a accueilli Tim Evans à ce poste. Auparavant, M. Evans a été directeur et vice-doyen de l’École de santé des populations et de santé mondiale de l’Université McGill et directeur général du Groupe de travail sur l’immunité face à la COVID-19, parmi d’autres postes de haute direction au niveau national et international.
M. Evans reconnaît le potentiel de recherche de l’Université. « Nous nous appuyons sur nos points forts, comme l’excellent travail réalisé dans les domaines de la durabilité et de la santé, déclare-t-il. Je considère que mon rôle consiste à essayer de favoriser et de stimuler cette croissance de manière à ce que l’Université continue de se démarquer clairement en tant qu’établissement d’influence. »
Bien que la découverte reste au cœur de la recherche, M. Evans souligne l’importance du suivi et de la pertinence dans le monde réel. « Je pense qu’il existe à Concordia une forte culture de la prestation et des retombées, qui continuera à nous distinguer des autres universités. »
À titre d’exemple, il cite la recherche sur la mise en œuvre menée par l’Institut des villes nouvelle génération de l’Université, dont les membres collaborent avec les municipalités pour mettre en œuvre des initiatives de développement durable dans les infrastructures urbaines et l’environnement.
« L’institut s’appuie sur la recherche axée sur la découverte s’intéressant à des enjeux comme la ventilation et le chauffage des bâtiments, et travaille avec des responsables clés pour que ces éléments soient intégrés aux codes du bâtiment et aux initiatives afin que nous puissions réellement faire avancer les choses en matière de villes vertes », explique-t-il.
En mettant l’accent sur la mise en œuvre, l’institut contribue à combler ce qu’on appelle le « fossé entre le savoir et l’action », c’est-à-dire « s’assurer que ce que nous savons être efficaces se traduit par des actions dans divers contextes », poursuit M. Evans.
« Bien des gens pensent que la recherche s’arrête à la démonstration que quelque chose fonctionne, comme les vaccins à ARNm, et sous-estiment l’important programme de connaissances associé à l’adoption de ces nouvelles technologies/vaccins par les personnes qui en ont besoin. Il faut donc investir pour mieux comprendre les processus décisionnels, la gestion des chaînes d’approvisionnement et le fonctionnement des systèmes d’approvisionnement, autant de domaines dans lesquels les connaissances facilitent la mise à l’échelle », ajoute-t-il.
« Par rapport à d’autres établissements universitaires, il semble que le système de recherche de Concordia fasse preuve d’une plus grande volonté et d’une plus grande expertise pour faire passer la recherche du stade de la découverte à celui de l’application et des résultats dans le monde réel. »


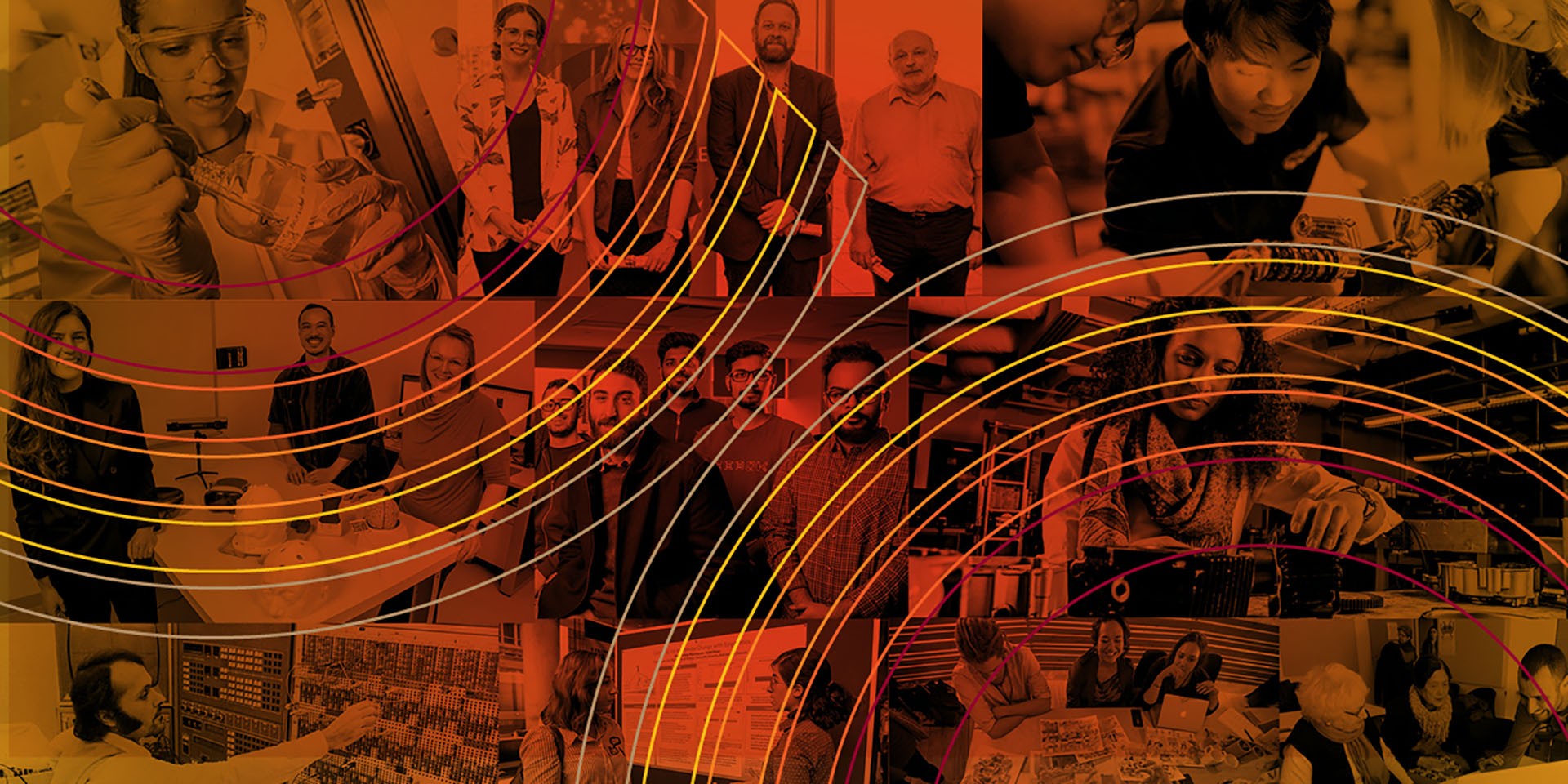
 « Si nous voulions progresser en tant qu’établissement de recherche, nous avions besoin d’un vice-recteur ou d’une vice-rectrice à la recherche » – Heather Adams-Robinette
« Si nous voulions progresser en tant qu’établissement de recherche, nous avions besoin d’un vice-recteur ou d’une vice-rectrice à la recherche » – Heather Adams-Robinette
 « Je pense qu’il existe à Concordia une forte culture de la prestation et des retombées, qui continuera à nous distinguer des autres universités. » – Tim Evans.
« Je pense qu’il existe à Concordia une forte culture de la prestation et des retombées, qui continuera à nous distinguer des autres universités. » – Tim Evans.