article
Quand la sagesse fait défaut dans un rapport qui ouvre la voie aux reculs
Cet articlé a été publié dans Le Devoir.
« Malgré le doublement des budgets de lutte contre l’homophobie et la transphobie en 2023, on constate une volonté de ralentir, voire de faire reculer certains droits », écrit l’auteur.
Le 30 mai, le comité des sages sur l’identité de genre mis sur pied par le gouvernement du Québec en décembre 2023 a publié son rapport tant attendu. Présenté comme une tentative d’équilibrer des points de vue divergents afin de favoriser le vivre-ensemble, le rapport propose une liste de suggestions sans insister sur des actions précises. À première vue, on pourrait croire à un exercice de prudence et de nuance. Pourtant, en y regardant de plus près, ses contradictions risquent de perpétuer précisément les discriminations qu’il prétend vouloir prévenir.
Une prudence qui mène à la complicité
Dès le départ, la conception même du comité a compromis son travail, et cette faille structurelle pèse lourd sur les choix politiques à venir.
Annoncé au milieu d’une série de manifestations antitrans, il servait avant tout de paravent politique — une manière pour le gouvernement d’éviter de se positionner sur des débats contentieux. Sa composition en disait long : aucun membre de la communauté trans, aucun expert cisgenre reconnu pour sa connaissance de ces réalités. On avait promis d’impliquer le Conseil québécois LGBT, mais sa participation était limitée. Ce qui aurait pu être un partenariat prometteur s’est révélé entièrement symbolique.
Bien que les biais méthodologiques et misogynes du rapport aient déjà été critiqués, la faisabilité de ses conclusions reste peu discutée. Or, les suggestions du comité alternent entre le banal, l’illusoire et le problématique. Certaines propositions, certes louables, réaffirment des principes déjà inscrits dans la loi, comme la nécessité de protéger les personnes trans contre la discrimination et les pratiques de conversion. D’autres exigent une volonté politique et un financement adéquat — par exemple, la création de toilettes universelles ou la formation des médecins — sans quoi elles ne verront jamais le jour.
Plus grave encore, plusieurs points s’appuient sur des théories scientifiquement infondées et largement contestées, telles que la « dysphorie de genre à apparition rapide » ou la « contagion sociale ». Ces propos alimentent la méfiance à l’égard des personnes trans et nourrissent des préjugés dangereux. En cela, le rapport donne du grain à moudre aux gens qui souhaitent revenir sur les acquis récents. Des groupes opposés aux droits des personnes trans y voient déjà des points encourageants.
Autrement dit, le poids réel de ces suggestions dépendra des décisions politiques à venir. Par exemple, le comité prétend viser un équilibre en proposant d’autoriser les centres d’hébergement pour femmes à refuser l’accès aux femmes trans, tout en encourageant le gouvernement à financer des organismes communautaires pour établir des refuges spécialisés. La première mesure est simple à mettre en œuvre et vient renforcer le mythe selon lequel les femmes trans menacent la sécurité des femmes cisgenres ; la seconde nécessite des ressources substantielles et reste bien plus difficile à réaliser.
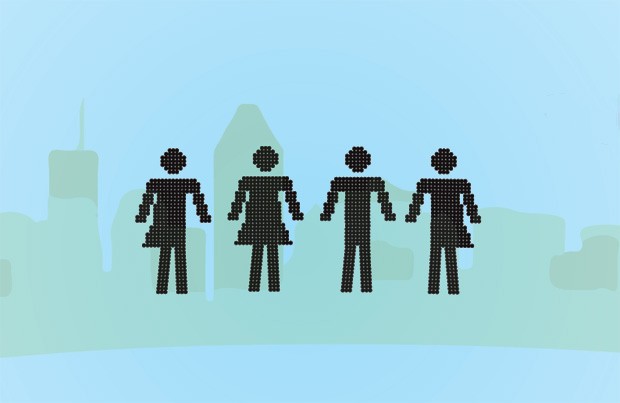
Si le gouvernement choisit de mettre en place la première sans la seconde, il invoquera sûrement le rapport du comité pour justifier ses actions, peu importent les nuances. Bref, en cherchant à éviter les écueils politiques, le comité a cultivé une apparence de neutralité face aux récits trompeurs sur les personnes trans. Ce faisant, il aura effectivement contribué à banaliser des stéréotypes nocifs qui alimentent la discrimination.
Quel avenir pour les droits trans au Québec ?
Ce qui adviendra dépendra de la réponse du gouvernement, mais les signes jusqu’ici sont préoccupants.
Malgré le doublement des budgets de lutte contre l’homophobie et la transphobie en 2023, on constate une volonté de ralentir, voire de faire reculer certains droits. Par exemple, en mai dernier, le ministre de la Justice a choisi de porter en appel le jugement reconnaissant la pluriparentalité sous prétexte de « protéger les enfants ».
Le mois suivant, le ministre de la Sécurité publique a annoncé que les personnes trans incarcérées seraient dorénavant détenues selon leur sexe « anatomique ». Ceci fait écho aux règles discriminatoires, éliminées il y a plus de 10 ans, qui forçaient les personnes trans à subir des interventions chirurgicales et stérilisantes pour accéder à une transition légale, rappelant la controverse du projet de loi 2 en 2021.
Dans un contexte où le Parti québécois et le Parti conservateur du Québec réclament des positions plus dures sur les enjeux trans, il sera difficile pour François Legault de résister à la tentation d’un bouc émissaire commode. En reprenant des arguments spécieux sur la protection des enfants et la sécurité des femmes, son gouvernement cède déjà à cette tentation. Les récents sondages qui suggèrent un effondrement de la Coalition avenir Québec pourraient bien renforcer ce choix.
Le risque est clair : en ignorant les suggestions qui visent à mieux protéger les droits des personnes trans, et en appliquant celles qui les encadrent plus sévèrement, le gouvernement contribuerait à normaliser l’intolérance alors que la violence contre les personnes trans ne cesse d’augmenter. Plutôt que de se contenter de demi-mesures dictées par le calcul électoral, nos élus doivent faire preuve du courage que la situation exige : celui de défendre les droits de toutes et tous, sans instrumentaliser les suggestions du comité pour justifier des politiques régressives.
Hélas, vu les choix déjà amorcés, il y a peu de raisons d’attendre un tel courage.

