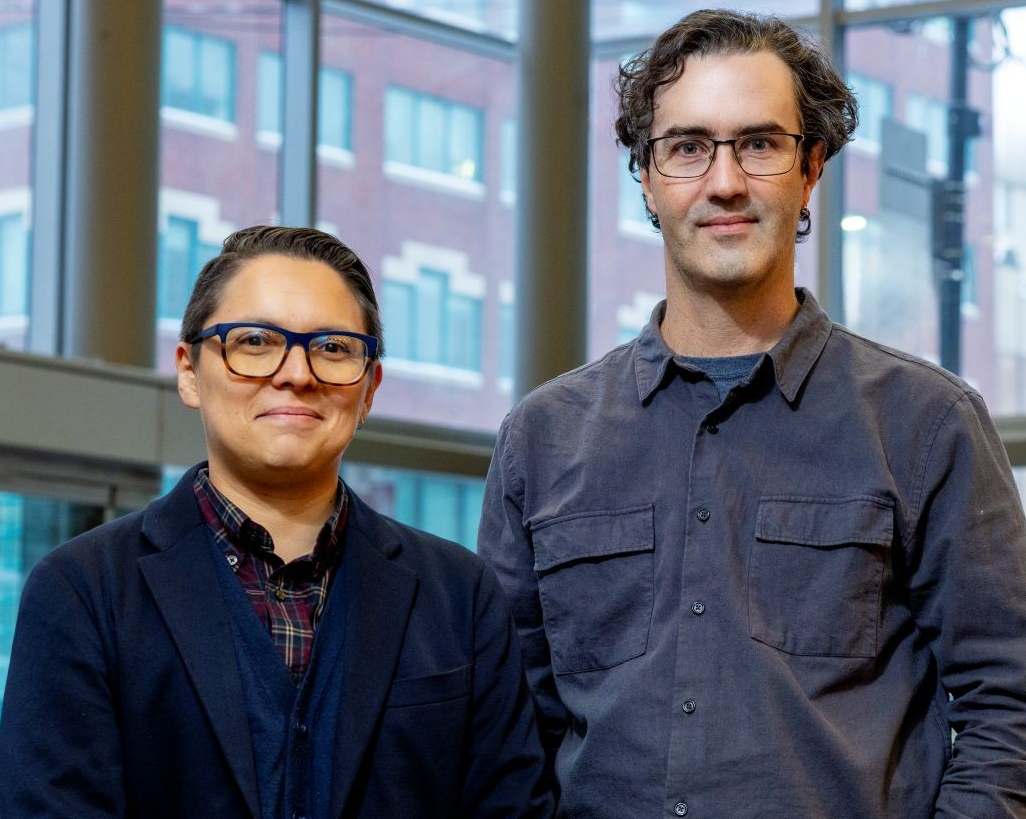À une époque où les Autochtones ne pouvaient quitter leur réserve sans document de voyage, de nouvelles amitiés ont vu le jour dans des lieux inattendus
 À gauche: James Greyeyes, première rangée au centre, avec ses quatre fils. À droite: Paysans doukhobors cultivant leur champ à la main.
À gauche: James Greyeyes, première rangée au centre, avec ses quatre fils. À droite: Paysans doukhobors cultivant leur champ à la main.
Un beau jour de printemps de 1909, mon arrière-grand-père, James Greyeyes, s’en va capturer des chevaux sauvages dans les plaines de la Saskatchewan. Il était parmi les seuls Cris libres de se déplacer hors de la réserve à une époque où l’on interdisait aux Premières Nations de la quitter sans document de voyage. Mais il avait conclu un marché avec l’agent des Indiens qui supervisait les affaires de notre communauté. James Greyeyes capturait, apprivoisait et vendait des chevaux sauvages aux fermiers et aux ouvriers de la région. C’est en faisant le commerce de chevaux que James parvenait à nourrir sa famille. Il s’était affranchi du système de laissez-passer en donnant une part de ses profits à l’agent des Indiens.
Né en 1877, époque où les Cris parcouraient encore librement les grandes plaines, James verrait, de son vivant, l’extinction de notre mode de vie et le début du génocide culturel orchestré par le gouvernement du Canada et les églises chrétiennes. À neuf ans, rien n’est déjà plus comme avant. Les derniers Cris à parcourir les plaines sont contraints de vivre dans les réserves. Sous le nouveau régime alimentaire étrange des rations gouvernementales, ils souffrent d’une famine généralisée. Quand on apprend que le missionnaire oblat de la région, le Père Louis Cochin, accepte des garçons comme élèves et leur sert un repas du midi, James est envoyé auprès de lui pour étudier. Converti au catholicisme, il apprend à lire, à écrire et à parler le latin pour ne plus avoir faim.
À la recherche de moyens pour étouffer toute trace de nostalgie de la vie nomade, le gouvernement du Canada mène une expérience afin de convertir plusieurs communautés autochtones à l’agriculture. Jeune homme, James se fait volontiers agriculteur et cultive de l’orge, de l’avoine et du foin sur son lot de 160 acres. Malgré sa réussite, l’agriculture ne lui permet pas de gagner sa vie décemment. Le succès d’agriculteurs des Premières Nations comme James suscite des plaintes de concurrence déloyale de la part des fermiers blancs. Par conséquent, les agents des Indiens sont chargés par les autorités gouvernementales de vendre les récoltes des Autochtones à des prix gonflés, de manière à favoriser les agriculteurs non autochtones. Les agriculteurs autochtones pouvaient consommer des œufs, du lait et du beurre, mais n’étaient pas autorisés à abattre les animaux qu’ils élevaient, si bien que, pour subvenir aux besoins de leur famille, de nombreux hommes cris devaient pratiquer la chasse et le piégeage en quittant la réserve clandestinement, sans laissez-passer, une infraction grave sous ce système. Pour James, seuls les chevaux lui appartenaient exclusivement.
Ainsi, en ce jour fatidique du printemps 1909, James part capturer d’autres chevaux. Parcourant les plaines à cheval, il tombe sur une nouvelle colonie de doukhobors, des exilés russes récemment arrivés au Canada. La scène devant lui le bouleverse. Les nouveaux arrivants labourent la terre pour y semer leurs cultures et, comme ils n’ont pas de chevaux, ce sont les femmes de la colonie qui tirent le soc, chevilles et jupes trempant dans la boue.
Après quelques minutes d’observation, James fait demi-tour et rentre chez lui. Il sélectionne quelques-uns de ses propres chevaux et retourne à la colonie des doukhobors. Comme James ne parle que le cri, et les doukhobors, seulement le russe, il leur fait comprendre par des gestes et quelques mots de latin qu’il leur prête ses chevaux pour labourer leurs champs. Puis, il reprend sa route pour aller capturer des chevaux sauvages.
« J’ai demandé à Kôhkom ce qu’elle en savait, et elle a écarquillé les yeux »
Trois semaines plus tard, James retourne à la colonie pour récupérer ses chevaux. Il se réjouit en apercevant les champs ensemencés où germent les cultures, mais à la vue de ses chevaux, la colère monte en lui. Ils étaient bien mal en point, amaigris, et l’un d’eux boitait. Sans dire un mot, il récupère ses chevaux et rentre chez lui.
Sur le chemin du retour vers la réserve, il a le temps de réfléchir. Il se dit que les doukhobors, en tant que nouveaux arrivants, n’ont peut-être pas les connaissances ni les ressources nécessaires pour prendre soin des chevaux comme il se doit. Alors, il retourne à la colonie le lendemain avec d’autres chevaux. Cette fois, il est accompagné d’un garçon de ferme qui a reçu l’ordre de rester avec les doukhobors pour leur montrer à prendre soin des chevaux.
À sa visite, un mois plus tard, il retrouve ses chevaux en santé. Il décide dès lors de les offrir à la colonie. Au fil des ans, James a recruté d’autres Cris de Muskeg Lake pour aider les doukhobors à s’établir au Canada.
J’ai découvert cette histoire en faisant des recherches pendant mes études supérieures sur la terminologie crie associée au cheval. Lorsque j’ai demandé à Kôhkom, ma grand-mère, si elle en avait entendu parler, elle a écarquillé les yeux. Elle ne connaissait pas cette histoire, survenue quatre ans avant sa naissance, mais elle venait élucider bien des mystères. Kôhkom m’a raconté que, toute son enfance, un homme à la longue barbe grise leur rendait visite à la fin de l’été. Les enfants étaient terrifiés et se cachaient à son arrivée. Sa longue barbe ressemblait à celle de certains pères oblats, et les enfants avaient peur qu’il ne soit là pour les amener au pensionnat.
Kôhkom se souvenait que l’homme arrivait toujours avec un chariot rempli de cadeaux pour sa famille : des vêtements, des couvertures, des gâteaux et du tabac ainsi que des nappes, des oreillers et des mouchoirs finement brodés, que sa mère ne sortait que pour les grandes occasions. Kôhkom m’a dit que l’homme s’asseyait et fumait en compagnie de son père. Ils parlaient très peu, mais lorsqu’ils échangeaient quelques mots, c’était en latin.
Manon Tremblay est la directrice principale des Directions autochtones.
Suggestions de lectures :
Donskov, Andrew. (2019). Leo Tolstoy and the Canadian Doukhobors: A Study in Historic Relationships. Ottawa : Presses de l’Université d’Ottawa.
Newhouse, David R., Voyageur, Cora J., et Dan Beavon. (2010). Hidden in Plain Sight, Contributions of Aboriginal Peoples to Canadian Identity and Culture. Toronto : University of Toronto Press.
Joseph, Bob. (2018). 21 Things You May Not Know About the Indian Act: Helping Canadians Make Reconciliation with Indigenous Peoples a Reality. Indigenous Relations Press.
Découvrez la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation le 30 septembre ainsi que les événements qui se dérouleront à l’Université, et inscrivez-vous à Pîkiskwêtân, la série sur l’apprentissage autochtone de Concordia.