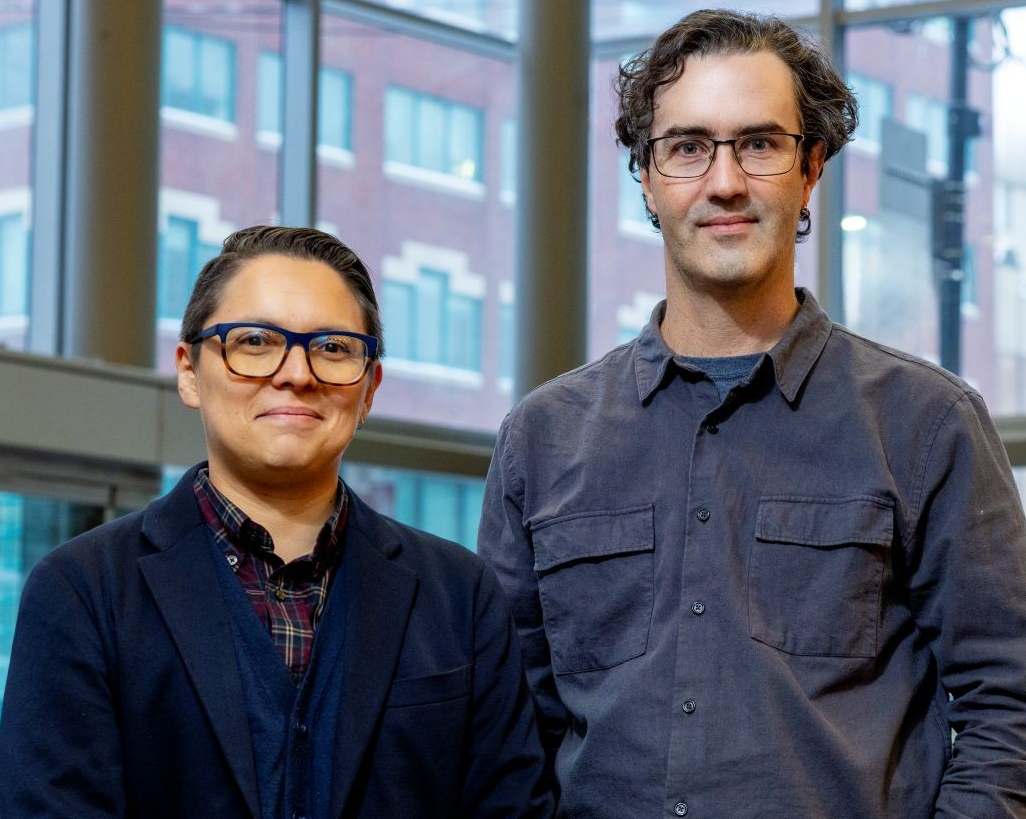La surimitation apparaît dès la petite enfance, mais n’est pas immédiatement liée à une préférence pour l’endogroupe, selon une étude de l’Université Concordia

Les humains sont, par nature, des animaux sociaux – bien plus que les autres primates. Notre désir d’acceptation par les membres de nos endogroupes est universel et inné. Il se manifeste également très tôt : de nombreuses études ont montré que l’imitation de comportements adultes par les enfants d’âge préscolaire permet d’acquérir de nouvelles compétences, de partager des connaissances culturelles et de favoriser un sentiment d’appartenance.
Une forme particulière de ce comportement est la surimitation, soit la tendance à reproduire des gestes qui ne sont pas nécessaires pour atteindre un objectif. Bien que la surimitation ait été étudiée chez les enfants âgés de trois à cinq ans, peu de recherches ont porté sur sa présence chez les enfants de moins de deux ans.
Dans le cadre d’une nouvelle étude, publiée dans la revue Frontiers in Developmental Psychology, une équipe de recherche de l’Université Concordia s’est penchée sur le phénomène de la surimitation chez des nourrissons âgés de 16 à 21 mois afin de déterminer si elle est liée à l’affiliation à un groupe social et à d’autres formes d’imitation et, le cas échéant, comment.
« La littérature scientifique donne à penser qu’une personne – même adulte – adopte un comportement de surimitation parce qu’elle souhaite s’affilier à la personne qui lui montre ces gestes », souligne Marilyne Dragon, doctorante au Laboratoire de recherche sur le développement de la cognition et du langage et auteure principale de l’article. « La personne veut montrer à la personne qu’elle imite qu’elle souhaite lui ressembler. » La surimitation est observée chez les chiens et les humains, mais pas chez les autres primates.
L’équipe de recherche a constaté que les jeunes enfants présentaient de faibles taux de surimitation et que ce comportement n’était pas motivé par une préférence pour les membres de leur endogroupe, c’est-à-dire qu’ils n’agissaient pas dans le but de plaire à une personne qui leur ressemblait. Ce résultat semble indiquer que la surimitation à des fins d’affiliation sociale pourrait apparaître plus tard. En revanche, l’équipe a établi une forte corrélation entre d’autres types d’imitation liés à la mémoire et à la cognition.
 « Nous pensons qu’il existe un lien entre la surimitation et la préférence pour l’endogroupe, mais qu’il se manifeste lorsque les enfants sont plus âgés », indique Marilyne Dragon.
« Nous pensons qu’il existe un lien entre la surimitation et la préférence pour l’endogroupe, mais qu’il se manifeste lorsque les enfants sont plus âgés », indique Marilyne Dragon.
Lien entre mémoire et cognition sociale
L’équipe de recherche a recruté 73 enfants, dont l’âge moyen était légèrement supérieur à 18 mois. Tous les enfants devaient accomplir quatre tâches, chacune conçue pour évaluer un type d’imitation particulier. Toutes les tâches reposaient sur une démonstration effectuée par une personne expérimentatrice, suivie d’une évaluation de la réaction de l’enfant.
La tâche de surimitation consistait à ouvrir une boîte contenant un jouet en suivant une séquence de trois gestes, dont l’un était inutile à l’atteinte de l’objectif. La tâche d’imitation suscitée, conçue à l’origine pour tester la mémoire, demandait à l’enfant de reproduire correctement une séquence de trois actions, comme coucher un ourson avec un oreiller et une couverture.
Dans le cadre de la tâche d’imitation d’intentions non accomplies, une personne expérimentatrice utilisait du matériel de jeu pour tenter une action, comme placer un chapelet de perles dans une tasse, sans réussir à la mener à bien. On demandait alors à l’enfant d’accomplir correctement l’action.
Enfin, pour la tâche de préférence pour l’endogroupe, l’enfant était assis devant un écran montrant une femme et un robot qui tenaient le même animal en peluche côte à côte et effectuaient les mêmes gestes simultanément. La personne expérimentatrice, cachée derrière un rideau sous l’écran, tendait les peluches au bout de baguettes, comme si elles étaient offertes par le robot et la femme. On évaluait si l’enfant saisissait d’abord le jouet offert par le robot ou celui offert par la femme.
« Nous voulions voir si les enfants présentaient le désir de s’affilier à quelqu’un qui leur ressemble davantage », explique Marilyne Dragon.
Seules les tâches d’imitation suscitée et d’imitation d’intentions non accomplies ont montré une corrélation claire. Les deux autres n’en ont révélé aucune.
« Nous pensons qu’il existe un lien entre la surimitation et la préférence pour l’endogroupe, mais qu’il se manifeste lorsque les enfants sont plus âgés, comme l’a montré une étude récemment menée dans notre laboratoire qui sera bientôt soumise pour publication », poursuit la chercheuse. À l’âge de quatre ans et demi, les enfants qui ont davantage recours à la surimitation ont tendance à préférer les enfants semblables à eux en matière de sexe et d’origine ethnique.
« Ces résultats mettent en évidence un schéma de développement où la surimitation est liée à la conscience de l’appartenance à un groupe », ajoute Diane Poulin-Dubois, coautrice de l’article et professeure au Département de psychologie.
Marilyne Dragon croit que les résultats indiquent que l’émergence de la surimitation nécessite davantage d’études, étant donné son importance dans le développement de l’enfant.
« Il est important que les parents et les personnes enseignantes soient conscients que les enfants vont les imiter, dit-elle. Ils vont reproduire et copier des gestes inutiles, et il faut en tenir compte. Nous voulons que les enfants développent leur pensée critique. »
Ce recherche a été soutenu par une bourse Insight du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.
Lisez l’article cité : I wanna be like you": testing the link between social affiliation and overimitation in infancy.