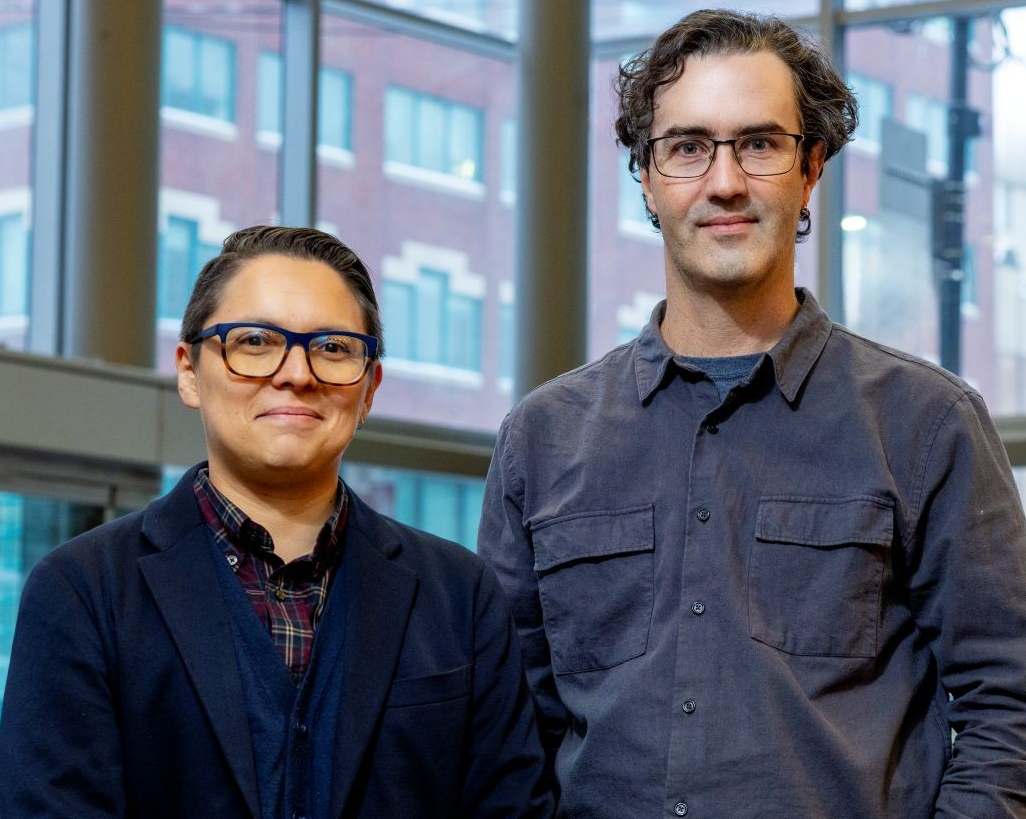Au-delà du test de résistance : propulser les universités au cœur du Montréal de demain
 Graham Carr | Photo: La Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Graham Carr | Photo: La Chambre de commerce du Montréal métropolitain
Chers amis, chers collègues, distingués invités, c’est un honneur pour moi de m’adresser à vous aujourd’hui. Merci à la Chambre pour l’invitation.
C’est la première occasion que j’ai de féliciter publiquement Isabelle Dessureault pour sa nomination. Pour ceux qui ne le savent pas, Isabelle détient un MBA de Concordia. Donc, Isabelle, nous sommes extrêmement fiers du travail que vous réalisez pour notre ville. Merci !
J’espère que vous avez tous apprécié la vidéo. Cela permet de planter le décor, car j’aimerais commencer par quelques bonnes nouvelles. D’abord, Concordia vient de mener à terme la plus ambitieuse campagne de financement de son histoire.
Cette campagne avait un objectif de départ de deux cent cinquante millions de dollars. Elle se terminera après avoir recueilli... En fait, nous ferons une annonce plus tard dans la journée. Vous comprendrez donc que je ne souhaite pas gâcher la surprise. Alors, je me contenterai de dire que nous avons dépassé, et largement dépassé, nos rêves les plus fous.
Ce résultat est d’autant plus remarquable compte tenu du contexte défavorable des dernières années – une pandémie, des conflits internationaux, une inflation galopante, et bien d’autres choses encore. Des dizaines de milliers de diplômés et d’amis ont contribué à cette campagne. Et le quart des sommes récoltées provient de quelque neuf cents entreprises. Plusieurs sont d’ailleurs dans la salle aujourd’hui. Je tiens à vous dire, merci !
D’autres bonnes nouvelles de ces dernières semaine : Jessica Lee Gagné, une diplômée de Concordia, est la première femme à remporter le prix Emmy de la meilleure direction photo pour la série Severance. J’ai hâte de féliciter Anne-Marie Croteau, doyenne de l’École de gestion John Molson. Bloomberg Businessweek vient de classer l’École John Molson comme la meilleure école de gestion au Canada.
Et, à Concordia, nous pouvons désormais affirmer littéralement que « The sky’s the limit. » Comme vous avez vu dans la vidéo, le club étudiant Space Concordia a lancé le mois dernier la première fusée depuis le sol canadien en plus de vingt-cinq ans. Leur réussite est un exemple de leur passion, de leur recherche et de leur persévérance – mais aussi de ce que le travail d’équipe peut accomplir.
Nous sommes vraiment fiers de leur collaboration avec la communauté crie de Mistissini, où le lancement a eu lieu. Certains membres de l’équipe Starsailor sont parmi nous aujourd’hui, et je tiens à les saluer. Pour bien des gens – comme nos donateurs, diplômés et étudiants – les universités représentent l’espoir dans un monde en turbulence. Elles ont la capacité unique de transmettre le savoir, stimuler l’innovation et développer les compétences nécessaires pour un avenir en rapide évolution.
Toutes les universités du Québec ont des réussites comme celles-ci. Elles apportent leur contribution unique et importante à notre société. Et mes collègues présents travaillent également sans relâche pour faire connaître les avantages que leurs propres institutions apportent à l’ensemble du Québec. Malheureusement, il devient de plus en plus difficile de remplir notre mission. Les universités sont mises à rude épreuve. Des défis inédits surgissent de toutes parts. Et la confiance du public envers notre secteur s’est considérablement effritée en cinq ans.
Aux États-Unis, l’hostilité ouverte envers les universités est choquante. En regardant ce qui se passe là-bas, tout aussi préoccupant est le faible nombre de personnes et d’institutions, notamment dans le monde des affaires, qui ont pris la défense des universités.
Ici, au-delà des perceptions, ce sont les politiques publiques qui mettent le plus à l’épreuve le secteur universitaire au Québec. L’économiste Pierre Fortin soutient que, depuis longtemps, les universités québécoises enregistrent un manque à gagner annuel d’au moins un-virgule-quatre milliards de dollars. Or, le budget présenté par le gouvernement du Québec le printemps dernier n’a prévu aucun nouveau financement pour les universités. Et on nous a prévenus que ce serait aussi le cas l’année prochaine.
En parallèle, les politiques canadiennes et québécoises qui visent à réduire le nombre d’étudiants internationaux ont considérablement aggravé ce sous-financement chronique. Au cours des cinq dernières années, il y a eu au moins dix changements majeurs de politiques touchant les étudiants provenant de l’extérieur du Québec.
En juillet, Moody’s a conclu que le Québec est « la province la plus restrictive du Canada pour les étudiants internationaux ». Rappelez-vous que c’est Moody’s – pas moi – qui l’a dit.
Vous êtes des gens d’affaires. Vous savez ce qui se passe lorsqu’on change les offres de services dix fois de suite en l’espace de peu de temps. Le marché devient instable. On perd la confiance des clients. Et bien sûr, les ventes disparaissent. C’est aussi ce qui se passe dans nos universités, dans vos universités. Personne ne sera surpris. Les universités québécoises ont constaté une baisse des inscriptions d’étudiants internationaux allant de vingt-cinq à cinquante pour cent.
Cela m’amène à poser deux questions : Pourquoi cela devrait-il vous préoccuper ? Et que peut-on faire collectivement pour améliorer les choses ?
Parlons d’abord des enjeux. Pendant des décennies, nous – les universités, les entreprises et les gouvernements – nous avons bâti une société prospère. En grande partie, notre prospérité réside dans la capacité à attirer et à former des personnes talentueuses provenant du monde entier.
Il y a tout juste deux ans, les universités montréalaises comptaient quarante mille étudiants internationaux. Selon une étude de Volume Dix – merci à Félix-Antoine Joli-Cœur – les étudiants internationaux contribuent plus de quatre milliards de dollars à l’économie québécoise. Cela représente presque la moitié de la taille du secteur de l’aluminium, un secteur important pour l’économie du Québec.
Beaucoup de ces étudiants choisissent de rester à Montréal pour y vivre et y travailler après leurs études. Il est probable que bon nombre d’entre eux se trouvent parmi nous aujourd’hui.
Ils sont aussi nombreux à lancer leur propre entreprise. Par exemple, l’incubateur d’entreprises de Concordia, District Trois, a aidé plus de mille trois cents entreprises à démarrer. Et la moitié de leurs fondateurs venaient de l’extérieur du Québec.
Warren Buffett a dit «It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it.» Depuis longtemps, Montréal est la ville canadienne la plus active en matière de recherche. Mais, des données récentes révèlent un changement inquiétant.
En 2017, QS a classé Montréal meilleure ville universitaire au monde. Cette année, nous sommes arrivés à la dix-huitième place. Aujourd’hui, Toronto et même Vancouver apparaissent devant Montréal dans le Global Cities Index d’Oxford Economics. Cela s’explique par leur niveau plus élevé de capital humain et d’innovation.
En même temps, des pays d’Asie, du Moyen-Orient et d’Afrique investissent massivement dans la construction d’établissements de calibre mondial. Selon le Times Higher Education, l’Asie compte désormais près de la moitié des meilleures universités du monde âgées de moins de 50 ans. Ce chiffre a doublé en cinq ans.
La concurrence est devenue de plus en plus féroce, importante et mondiale dans notre secteur. Combien de temps pouvons-nous considérer nos universités comme acquises avant de perdre notre avantage ? Je crois qu’on a atteint ce point critique.
Soyons clairs : Oui, on a toujours des étudiants formidables du Québec. Mais nos universités – de même que nos cégeps – perdent déjà certains de leurs meilleurs étudiants potentiels à cause des problèmes d’immigration et des restrictions sur les permis d’études.
Si la tendance se maintient, la douleur que nous ressentons aujourd’hui, vous allez la ressentir demain. Dans trois, quatre ou cinq ans, votre bassin de talents ne sera plus le même. Il sera moins diversifié, moins polyglotte, moins cosmopolite. Les politiques actuelles compromettent votre accès au talent, un moteur clé de la prospérité de Montréal.
L’avantage des difficultés, c’est qu’elles nous permettent d’identifier les changements qui s’imposent. Un de ces changements, c’est le besoin pressant de renforcer la collaboration entre les universités et le milieu des affaires. Et tout commence par le talent.
À Concordia, on met l’accent sur l’apprentissage en milieu de travail. Chaque année, plus de 2000 de nos étudiantes et étudiants font un stage rémunéré. En 2024-25, ils ont travaillé pour près de sept cents organisations de toutes tailles à Montréal et partout au Québec.
Ces placements les aident à développer leurs compétences professionnelles et à faire la transition vers le marché du travail. Pour les étudiants internationaux, il s’agit d’une porte d’entrée vers la société québécoise. Et pour vous, les stages sont une source renouvelable d’employés potentiels qui apportent avec eux une expertise dans les derniers développements technologique et numériques.
Les programmes coopératifs constituent un moyen éprouvé de préparer les jeunes à réussir sur le marché du travail québécois. Si votre organisation souhaite renforcer son vivier de talents, c’est par là qu’il faut commencer.
Cependant, compte tenu de l’ampleur des défis actuels, les approches traditionnelles ne suffisent plus. Attirer, développer et retenir les talents doivent être au cœur de toutes nos activités et vos activités.
C’est pourquoi Concordia a ancré notre projet PLAN/NET ZERØ dans des formes innovantes de partenariats entre l’industrie et l’université – tout en privilégiant les talents. L’objectif de PLAN/NET ZERØ est de décarboner entièrement nos deux campus d’ici 2040.
Malgré ce que vous avez pu entendre de la part d’un certain orateur aux Nations Unies cette semaine, la crise climatique est bien réelle. Dans ce contexte, la décarbonation des infrastructures existantes est l’un des grands défis de notre époque. Et nos deux campus nous offrent quatre-vingts bâtiments qui représentent cent cinquante ans d’histoire architecturale.
Vous vous souvenez peut-être que nous avons annoncé PLAN/NET ZERØ devant la Chambre au printemps 2023. Eh bien, cela a évolué. Tout d’abord, nous faisons équipe avec deux grandes sociétés québécoises. Concordia travaille avec Hydro-Québec et Énergir pour mettre en œuvre des solutions énergétiques durables sur le campus Loyola. Et nous venons tout juste d’annoncer un projet de modernisation avec Johnson Controls, un chef de file en technologies pour bâtiments intelligents.
Concordia deviendra un véritable laboratoire vivant. Les projets de PLAN/NET ZERØ favorisent la co-innovation et la recherche appliquée grâce à la collaboration entre les étudiants, les chercheurs, les partenaires industriels et les communautés. Dans le cas du campus Loyola, cela pourrait même mener à un partage de l’énergie avec les quartiers environnants.
Notre but est d’utiliser les résultats de ce travail pour développer des programmes de formation qui répondront directement à vos besoins émergents. Et des solutions que d’autres pourront reproduire.
Nous sommes convaincus que ces projets stimuleront à terme la croissance de l'économie verte à Montréal et dans tout le Québec. Nous réussirons parce que nous préparons nos étudiants et vos employés à devenir des leaders de la transition énergétique.
Les universités québécoises et le secteur privé ont une longue histoire de partenariats fructueux. Je vais terminer donc par un appel urgent à collaborer une fois de plus. Il faut freiner la perte de talents, retrouver notre élan, et redonner à notre ville la place qu’elle mérite comme pôle d’attraction pour le monde entier.
C’est ainsi qu’on recommencera, comme Isabelle l’a dit récemment, « à être ambitieux à Montréal, à viser grand. »
Merci.