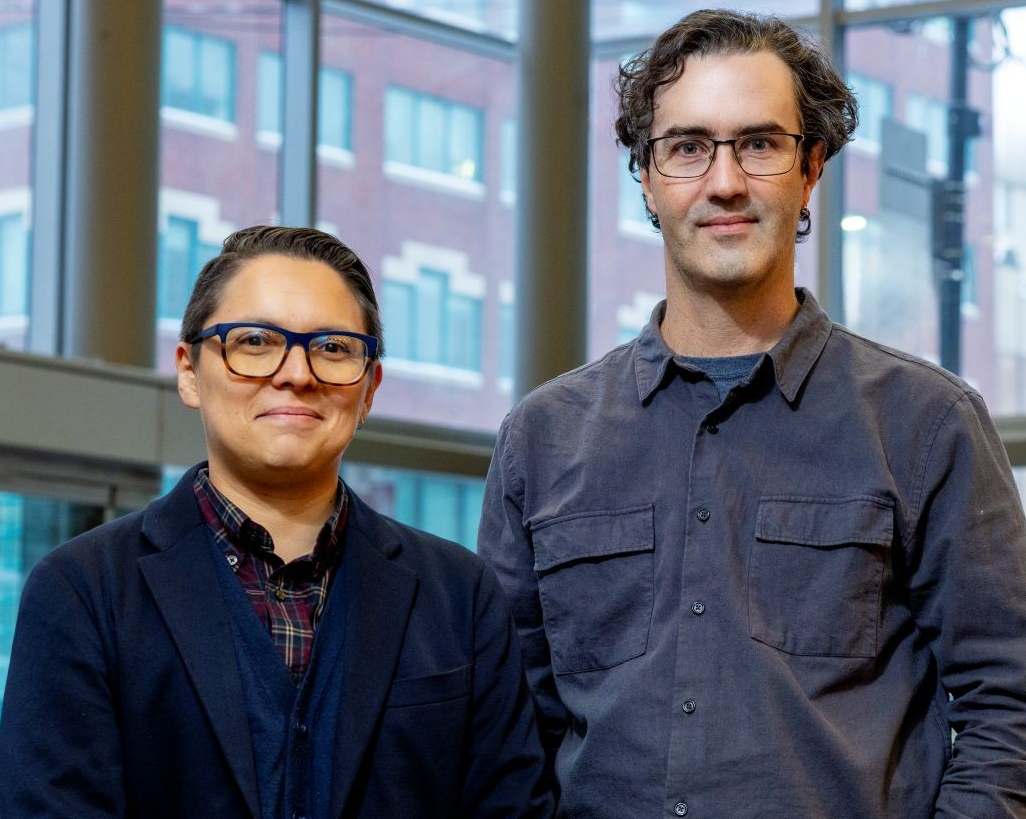Une équipe de recherche de l’Université Concordia conçoit un modèle durable de « ville du quart d’heure » alimentée à l’énergie solaire

Dans le sillage de l’urbanisation rapide du siècle dernier, les villes nord-américaines centrées sur la voiture sont devenues la norme. Or, l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre et des prix du carburant pousse chercheurs et urbanistes à se tourner vers des solutions innovantes en matière d’aménagement urbain.
En s’appuyant sur près d’une décennie de recherches sur les quartiers à vocation mixte adaptés à l’énergie solaire, une étude menée par des chercheuses et chercheurs de l’Université Concordia propose un nouveau modèle de développement urbain. Publiée dans la revue Sustainability, l’étude porte sur l’intégration de stratégies clés visant à garantir un avenir sous le signe du respect de l’environnement et de la sécurité alimentaire. Ce modèle combine le concept de « ville du quart d’heure », la production d’énergie renouvelable, les transports écoénergétiques et l’agriculture urbaine dans un cadre unique permettant de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre tout en mettant en place une infrastructure agricole urbaine et en renforçant les liens au sein des communautés.
« Nous voulons voir comment nous pouvons intégrer énergie, mobilité, utilisation des terres et fonctions sociales afin de réduire la distance entre les résidents et les endroits où ils se rendent pour répondre à leurs besoins quotidiens et, ce faisant, de diminuer le nombre de trajets exigeant la consommation d’énergies fossiles », explique Caroline Hachem-Vermette, auteure source de l’étude et professeure agrégée au Département de génie du bâtiment, civil et environnemental.
« Notre objectif global est de concevoir des regroupements de quartiers interconnectés qui partagent nourriture, énergie et commodités, de manière à créer un réseau urbain équilibré et adaptable. »
Un modèle adaptable à tous les quartiers
Le cadre de production et de transport alimentaires, tel qu’il est décrit dans l’étude, est un système évolutif conçu pour rendre les quartiers plus durables et plus agréables à vivre. Il fait appel à des variables spatiales, agricoles, énergétiques et économiques afin de mesurer la durabilité des quartiers.
Le modèle s’appuie sur le principe de « ville du quart d’heure », selon lequel les commodités essentielles telles que les épiceries et les marchés fermiers sont uniformément réparties sur le territoire et facilement accessibles, généralement à moins d’un kilomètre des lieux de résidence. Les toits, les façades et les terrains sous-utilisés sont transformés en potagers grâce à des projets d’agriculture urbaine. Un parc de véhicules électriques alimentés par des panneaux photovoltaïques intégrés aux trottoirs achemine les produits locaux vers des épiceries et des marchés fermiers situés à proximité.
Le cadre prend en compte la surface des toitures, des façades et des terrains disponibles pour la culture, les distances à parcourir à pied entre les résidences et les commodités locales, les rendements agricoles et la demande alimentaire par habitant, ainsi que l’efficacité des panneaux solaires, la capacité des batteries des véhicules électriques et les taux de réduction des émissions de CO₂. Des éléments économiques tels que les coûts énergétiques et les périodes de récupération servent de guide en matière de faisabilité.
L’équipe de recherche a également introduit un indicateur de prise de décision permettant de quantifier le rendement des stratégies de conception dans différentes configurations de quartiers. Cet indicateur fournit aux urbanistes et aux décideurs politiques un outil facile à interpréter pour comparer différents scénarios.
« L’objectif a toujours été de bâtir un modèle relativement simple et transparent, car lorsque vous mettez en place des quartiers à vocation mixte, les membres de la communauté sont d’importants participants », fait valoir l’auteur principal et étudiant à la maîtrise Faisal Kabir.
Émissions et économies
L’équipe a appliqué son modèle au quartier West 5 de London, en Ontario. Cette communauté solaire intelligente fait office de laboratoire vivant dans le cadre du programme de recherche sur l’électrification Volt-Age de Concordia.
L’équipe a découvert qu’en consacrant seulement 13,8 % de la surface des toits, 10 % des façades et 15 % des terrains à l’agriculture urbaine, un quartier pouvait devenir totalement autosuffisant en légumes-feuilles et autres légumes. Dans cet environnement, les émissions de carbone montrent une diminution de 98 % par rapport aux systèmes courants axés sur les transports.
De plus, le réseau de transport alimenté à l’énergie solaire a permis de réaliser des économies à long terme : la période de récupération des investissements dans le réseau n’a été que de 2,8 années, et le coût de l’électricité propre générée a été d’environ 0,92 $ par kilowattheure.
Selon les calculs de l’équipe de recherche, chaque 0,19 unité de production alimentaire locale compense une unité d’émissions de CO₂, ce qui montre que de petites initiatives locales peuvent avoir d’importantes retombées environnementales.
« Le fait de cultiver des aliments et de les partager avec ses voisins favorise l’établissement de liens authentiques. Lorsque les gens apprennent à se connaître, ils commencent à s’entraider, ce qui est un élément fondamental de la résilience, soutient Caroline Hachem-Vermette. Au-delà des avantages en matière d’alimentation et d’émissions de carbone, un sentiment d’appartenance à une communauté est créé. »
Cette étude constitue une étape d’un programme plus vaste actuellement mené par le groupe de Caroline Hachem-Vermette. Depuis 2015, ce programme explore comment l’énergie, la mobilité, l’utilisation des terres et les facteurs sociaux peuvent être intégrés à l’échelle des quartiers. Dans le cadre des prochaines étapes, la même approche de modélisation sera appliquée aux lieux de travail, aux écoles, aux établissements de santé et aux installations récréatives, ainsi qu’aux liens régionaux. L’objectif est de faire progresser la concrétisation d’une vision où les villes sont conçues comme des réseaux interconnectés de quartiers à vocation mixte partageant leurs ressources.
Les trois stratégies examinées dans l’étude contribuent à la réalisation de plusieurs Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD 2, 7, 11 et 13) en soutenant des initiatives axées sur la lutte contre la faim, l’énergie propre, les villes durables et l’action climatique.
Mahnoor Fatima Sohail a contribué à la recherche dans le cadre de cette étude.
Lisez l’article cité : « Adapting the 15-Minute City to North America: A Framework for Neighbourhood Clusters with Urban Agriculture and Green Mobility »