Le rôle des conseils d’administration d’entreprises dans la gouvernance climatique
 Membres du comité de gouvernance climatique, de gauche à droite : Nancy Desrosiers, Sophie Audousset-Coulier, Anne-Josée Laquerre, Anne-Marie Croteau, Emmanuelle Letourneau, Sonia Li Trottier, Claudine Trahan, Jordan Lebel
Membres du comité de gouvernance climatique, de gauche à droite : Nancy Desrosiers, Sophie Audousset-Coulier, Anne-Josée Laquerre, Anne-Marie Croteau, Emmanuelle Letourneau, Sonia Li Trottier, Claudine Trahan, Jordan Lebel
« Les crises sont porteuses de possibilités », a fait remarquer Jordan LeBel, directeur des études du Centre des dirigeants John-Molson, à l’ouverture de l’atelier sur la gouvernance climatique, qui s’est tenu le 28 mars.
Ces propos reflètent bien l’esprit de l’événement : l’instabilité écologique, économique et géopolitique de notre époque peut servir de catalyseur pour repenser la manière dont les organisations abordent les risques climatiques et la création de valeur à long terme.
L’atelier a été organisé par Anne-Marie Croteau, doyenne de l’École de gestion John-Molson, en collaboration avec le Centre des dirigeants John-Molson, L’Initiative canadienne de droit climatique, Québec Net Positif et l’Institut du climat de l’École de gestion John-Molson. L’événement, qui réunissait des membres de conseils d’administration, des universitaires et des professionnels du secteur, visait à aborder l’évolution des responsabilités des conseils d’administration des entreprises en examinant trois questions clés :
Comment les administratrices et administrateurs peuvent-ils renforcer leur rôle de surveillance et de conseil sur les questions climatiques?
Comment intégrer la gouvernance climatique dans la chaîne de valeur?
Comment mobiliser les personnes alliées?
Définir le rôle des membres des conseils d’administration
L’atelier a étudié les questions que les membres des conseils d’administration doivent se poser dans leur double rôle de superviseurs et de conseillers en matière de gouvernance climatique, laquelle doit encore être intégrée de manière concrète aux priorités des conseils d’administration.
Souvent, la sensibilisation climatique des membres varie, allant d’un constat superficiel à une véritable volonté d’agir. Comme l’a fait remarquer une personne participante, la question n’est plus de savoir si les enjeux climatiques ont leur place dans la salle du conseil d’administration, mais plutôt si on a les bonnes personnes, dotées de la bonne expertise, autour de la table pour poser les questions difficiles et agir en conséquence.
Plusieurs ont souligné que les conseils d’administration reçoivent souvent des bilans financiers contenant peu ou pas de données sur l’impact environnemental, ce qui rend difficile l’acquisition d’une littératie climatique. Pour combler cette lacune, il est essentiel de mettre en place une formation continue et de disposer de données complètes sur les effets des changements climatiques.
« Il ne suffit pas de supposer que les membres des conseils d’administration comprennent les risques climatiques, a fait valoir une personne participante. Il faut offrir une formation de base pour s’assurer que tout le monde au sein de l’organisation est sur la même longueur d’onde. »
Les participantes et participants ont également convenu que la gouvernance climatique constitue fondamentalement une bonne gouvernance, qui n’est atteignable qu’en tenant compte des questions climatiques dans tous les aspects du fonctionnement de l’organisation, du cycle de vie des produits aux relations avec les fournisseurs. Il est également essentiel que les attentes relatives au climat soient clairement communiquées aux partenaires et aux parties prenantes.
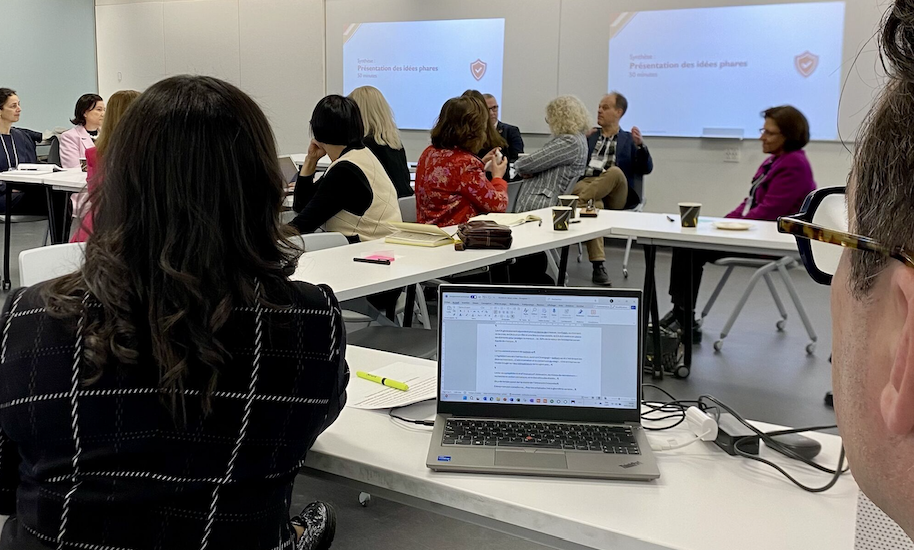 Discussion de groupe dans le cadre de l’atelier sur la gouvernance climatique à l’Université Concordia le 28 mars 2025.
Discussion de groupe dans le cadre de l’atelier sur la gouvernance climatique à l’Université Concordia le 28 mars 2025.
Gouvernance climatique et chaîne d’approvisionnement
L’atelier a examiné comment les entreprises peuvent exploiter leurs chaînes d’approvisionnement pour faire progresser la gouvernance climatique. Par exemple, Cogeco a délocalisé ses activités hors de la Floride en raison des situations météorologiques extrêmes – un exemple d’atténuation des risques climatiques et non d’action climatique directe. Hydro-Québec, pour sa part, a revu ses stratégies d’approvisionnement pendant la pandémie afin d’améliorer la résilience de la chaîne d’approvisionnement, démontrant ainsi que les considérations climatiques peuvent influencer les décisions opérationnelles.
« Les conseils d’administration ne doivent pas tomber dans le piège de la gestion directe de l’entreprise, a affirmé une personne participante, mais lorsqu’une crise de la chaîne d’approvisionnement survient, elle remonte très rapidement au conseil d’administration. »
De grandes entreprises comme IKEA provoquent déjà le changement en exigeant de leurs fournisseurs qu’ils mesurent et déclarent leurs émissions, sous peine de perdre leur contrat.
Des initiatives de collaboration, comme le Conseil canadien des normes d’information sur la durabilité, s’avèrent efficaces, réunissant les grandes entreprises et leurs fournisseurs pour qu’ils s’harmonisent avec les objectifs du champ d’application 3. Ces objectifs, qui visent à réduire les émissions indirectes dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, sont difficiles à atteindre sans tenir compte des considérations climatiques dans l’approvisionnement. Toutefois, les personnes participantes ont reconnu que cette intégration demeure une faible priorité pour de nombreuses entreprises.
Fait intéressant, les petites et moyennes entreprises (PME) pourraient être mieux placées pour mettre en œuvre un approvisionnement durable en raison de leur agilité intrinsèque. En revanche, les grandes entreprises sont souvent limitées par des systèmes complexes.
Mobiliser les personnes alliées
La dernière discussion a porté sur la manière de faire de l’action climatique une priorité dans l’ensemble des écosystèmes organisationnels. À cette fin, les participantes et participants ont souligné l’importance d’intégrer les risques climatiques dans les cadres obligatoires de gestion des risques.
« Les conseils d’administration sont souvent plus réactifs que proactifs, a expliqué une personne participante. La mobilisation de parties prenantes – actionnaires, clients ou réseaux d’employés – peut toutefois contribuer à réorienter les priorités. »
Les nouvelles générations pourraient être un moteur de cette réorientation des priorités. D’ici cinq ans, les générations Y et Z devraient compter pour près du tiers de la main-d’œuvre, et leurs attentes en matière d’action climatique sont plus élevées que celles des générations précédentes. Suggestion avant-gardiste : réserver au moins un siège au conseil d’administration à une personne de moins de 35 ans pour tenir compte de ces perspectives.
Après tout, l’inaction comporte ses propres risques. Au-delà des inondations et des feux de forêt, les atteintes à la réputation et la perte de talents pourraient être considérables.
Si certains membres des conseils d’administration craignent l’activisme des parties prenantes, d’autres le considèrent comme une force constructive. Les regroupements locaux de PME et les réseaux d’affaires influents, dont la Fédération des chefs d’entreprises du Québec, pourraient constituer des plateformes essentielles pour promouvoir de manière naturelle les idées et l’action climatique collaborative.
Pour mobiliser efficacement les parties prenantes et les personnes alliées, il faut trouver un équilibre stratégique : intégrer des objectifs clairs et mesurables, stimuler une participation proactive des parties prenantes dans l’écosystème organisationnel et renforcer la résilience interne pour évoluer dans le paysage de plus en plus complexe de la gouvernance climatique.
Inspirez les nouvelles idées
Au fil des discussions, une métaphore récurrente a émergé : la nécessité pour les acteurs de passer d’un rôle de moustiques – agaçants et inefficaces – à celui de pollinisateurs, qui sèment des idées, créent des liens et contribuent à faire évoluer les systèmes pour les faire prospérer.
« Ne vous contentez pas de piquer une fois et de disparaître, a fait remarquer une personne participante. Apportez des connaissances et des données, renforcez les capacités. Inspirez les nouvelles idées. »
Si un message marque les esprits, c’est que la gouvernance climatique n’est plus considérée comme une simple option, mais comme un impératif stratégique qui demande du courage, de la collaboration et une nouvelle vision du leadership face aux défis climatiques.

