article
Le Québec a tout pour réussir sa révolution batterie
Cet article a été publié dans Le Devoir.
Depuis quelque temps, la filière batterie québécoise fait l’objet d’un traitement médiatique pour le moins partial. Les investissements publics consentis par les gouvernements fédéral et provincial sont régulièrement pointés du doigt, souvent sans réelle analyse des faits. Que se passe-t-il réellement au Québec ?
Commençons par les bases. Une batterie lithium-ion, c’est simple : une anode, une cathode et un électrolyte. Le lithium circule entre les deux électrodes sous forme ionique, d’où le nom. Contrairement aux anciennes batteries au plomb ou nickel-cadmium, elle accepte diverses chimies, comme le fer-phosphate (LFP) ou le nickel-manganèse-cobalt (NMC).
Légère et dotée d’une densité énergétique supérieure, la batterie lithium-ion doit ses performances au lithium, le métal le plus léger de l’univers. Son petit rayon ionique lui permet ainsi de s’insérer facilement dans la plupart des structures d’anodes et de cathodes.
La filière batterie suit un parcours complet : mine, transformation, précurseur de cathode (PCAM), cathode (CAM), cellule, module, pack, seconde vie et recyclage. Elle tend vers une circularité croissante. Il est fondamental de distinguer les PCAM des CAM, qui relèvent de deux étapes distinctes de la chaîne de valeur.
À Bécancour, plusieurs entreprises fabriqueront de l’hydroxyde de lithium (PCAM) et du NMC (CAM) destinés à la production de batteries. Ces composants ne servent pas qu’aux véhicules électriques ! Les batteries lithium-ion sont partout : téléphones, ordinateurs, outils électriques, stockage résidentiel ou industriel, intégration du solaire et de l’éolien, véhicules électriques, trains et même avions légers.
L’Amérique du Nord a manqué plusieurs révolutions industrielles. Ce n’est pas du FOMO, c’est un simple constat historique. Le brevet fondateur de la batterie lithium-ion fut déposé à la fin des années 1970 par le CNRS et Hydro-Québec, mais c’est Sony qui lança la première batterie commerciale en 1991. L’Occident, dépendant des énergies fossiles, ne voyait pas l’intérêt du stockage.
Le Japon, soutenu par le MITI et son programme New Sunshine Project (1992-2001), a persévéré et financé massivement la recherche. Il devint leader mondial dans les années 1990. Même après la faillite de la giga-usine Asahi Toshiba, les Japonais ont continué. La Corée a ensuite attiré leurs ingénieurs : LG Energy Solution est devenu en 2021 le nº2 mondial (26 % du marché), et Samsung SDI, le nº4.
La Chine, à partir des années 2000, a massivement investi pour électrifier sa flotte urbaine et réduire la pollution. Elle a démontré la viabilité du fer-phosphate lithié à l’exposition universelle de Shanghai en 2010. Cette technologie, découverte en Amérique du Nord (Université du Texas, CNRS, UdeM, Hydro-Québec), fut industrialisée grâce à une planification étalée sur 20 ans. Résultat : la Chine concentre aujourd’hui 75 % de la capacité mondiale de fabrication des batteries.
Et le Québec, dans tout ça ? En 2014, nous avions tenté de convaincre le premier ministre Harper d’implanter une giga-usine Sony au Québec. Ce dernier avait refusé poliment, préférant soutenir les secteurs pétrolier et gazier. Nous avons raté cette occasion en or. Nous n’avions toutefois pas baissé les bras : une coentreprise entre Sony et Hydro-Québec, Estallion, a vu le jour, produisant des conteneurs de batteries dont la cellule unitaire était fabriquée au Japon.
Depuis 2018, tout a changé. Grâce à François-Philippe Champagne, Pierre Fitzgibbon et Guy Leblanc, un plan stratégique clair a permis l’essor de la filière québécoise. L’idée : transformer nos matériaux critiques pour maximiser la valeur de notre hydroélectricité et devenir un champion non seulement de la production verte, mais aussi du stockage.
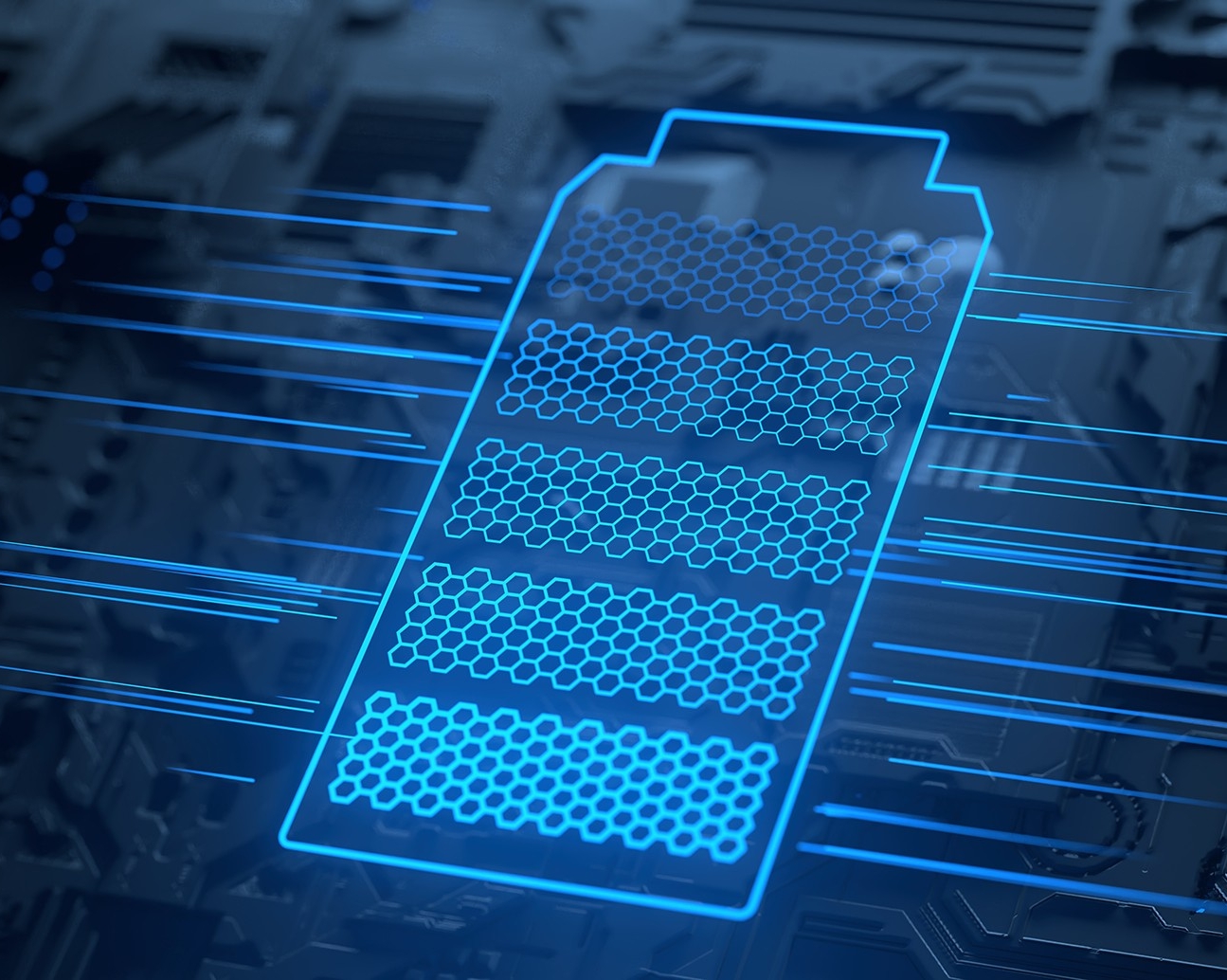
Le Québec dispose d’atouts exceptionnels : abondance de minéraux critiques (cuivre, graphite, lithium, nickel, cobalt, fer, phosphate, aluminium), énergie verte à bas coût, infrastructures portuaires et ferroviaires à Bécancour, capital humain hautement qualifié et accords de libre-échange avec tous les membres du G7. Et depuis plus d’un demi-siècle, grâce à l’Institut de recherche d’Hydro-Québec, la province a su bâtir un écosystème batterie reconnu et envié mondialement. Peu d’endroits cumulent autant d’avantages.
Nous avons déjà des succès. Nouveau Monde Graphite développe une mine et une usine d’anode avec Panasonic et GM ; Nemaska Lithium construit une usine de conversion de spodumène en hydroxyde de lithium ; Ultium CAM implante sa production de matériaux de cathode…
Certains objectent : « Le marché des véhicules électriques ralentit, la Chine domine, le contexte géopolitique est instable. » C’est vrai. Les tensions commerciales et les guerres fragilisent toutes les chaînes industrielles — pas seulement celle des batteries. Faut-il pour autant renoncer ? Au contraire. Dans un monde incertain, disposer d’une filière locale de transformation des matériaux critiques est un atout stratégique majeur. Elle réduit la dépendance aux chaînes mondiales vulnérables et fait du Québec un fournisseur fiable pour ses alliés.
Construire une filière de A à Z exige vision, investissement et patience. Les faillites et adaptations font partie intégrante de tout cycle industriel.
Le réchauffement climatique s’accélère : les énergies fossiles causent 8,7 millions de morts par an (Harvard, 2021). La transition énergétique n’est plus un choix, mais une nécessité vitale.
Cette urgence ouvre un immense champ d’innovation. Plutôt que d’exporter nos ressources à bas prix, nous pouvons les transformer ici pour créer de la valeur, dans tous les secteurs (civil et défense). Elle invite aussi à repenser nos usages : plus de 95 % des automobilistes roulent seuls ; il faut concevoir des véhicules plus petits, plus légers et plus sobres. L’électrification des bâtiments et la montée en puissance de l’intelligence artificielle placent le stockage d’énergie au cœur de notre avenir.
Nous avons une occasion historique de devenir un acteur clé d’une industrie mondiale en expansion. Nous avons les ressources, l’énergie, les infrastructures et le talent. Critiquer chaque difficulté ou ajustement, c’est risquer de rater encore le train de l’histoire. Le Québec doit choisir : être spectateur ou acteur de la révolution énergétique du XXIᵉ siècle.

